 Camus est vêtu d’un costume léger bleu marine. Sous la veste, son éternel gilet de laine gris. Il a l’air fatigué. Son bureau est encombré de livres, de papiers, de photos d’acteurs. La fenêtre est fermée.
Camus est vêtu d’un costume léger bleu marine. Sous la veste, son éternel gilet de laine gris. Il a l’air fatigué. Son bureau est encombré de livres, de papiers, de photos d’acteurs. La fenêtre est fermée.
Il se lève pour m’accueillir.
- Alors, ma chère, nous avons enfin un théâtre...
- Oui, monsieur, enfin !
- Je n’aurais jamais cru que ce fût si difficile, soupire-t-il.
Bon, la pièce est longue, lourde... une lourde machine... Et tous ces comédiens.... Mais enfin voilà : c’est encore une femme qui a le courage.
Je souris :
- C’est elle qui en aura le succès...
- Chut... ne mettons pas les dieux contre nous... Si vous saviez comme je doute... Dans un mois on répète et je ne suis sûr de rien...
Ce n’est pas à moi à le réconforter. J’ouvre ma serviette et sors les documents à signer. Il tend la main, les pose devant lui tout en suivant le cours de sa pensée.
- Que pensez-vous de Catherine Sellers ? L’avez-vous déjà vue sur une scène ?
Il me parle comme à un agent. Après tout, oui, je suis la secrétaire de son agent.
- Non, je ne l’ai jamais vue. Seulement des photos... Elle a un beau visage tourmenté... des pommettes hautes comme les slaves... Je l’imagine bien jouant Maria.
Il rêvait.
- Elle est parfaite. Et quel métier... Une actrice shakespearienne.
N’y tenant plus, je lance :
- Vous l’aimez ?
Il est pris au dépourvu. Je vois dans ses yeux le travail de décodage : “veut-elle dire que je l’aime comme artiste, que j’aime son jeu, ou bien a-t-elle le culot de me demander si je l’aime d’amour ?”
Mais il est trop fin pour douter longtemps. Il est honnête, aussi. Et puis il est devant une femme.
- Oui, je l’aime.
Il prend un crayon posé sur la table et le fait rouler, du doigt, entre deux piles de livres. Avancer, reculer, avancer, reculer. Lui a décidé d’avancer. De se livrer.
- J’aime plusieurs femmes, d’un amour total et différent. Il y a plusieurs sortes d’attentes... il y a plusieurs sortes de charmes qui opérent sur moi... et qui n’enlèvent rien aux autres... Pourquoi n’aimer qu’une fois ? Il y a tant à donner.
- Mais votre femme ?
- C’est ma femme. Elle est mon point d’attache.
Il a l’air grave, celui qu’il doit avoir en écrivant. Nous avons trop parlé de lui.
- Et vous ?
Il dit cela sans vraiment questionner, comme une parade.
- Je vais prendre des cours de comédie.
Bien, sa pensée bascule. Il accuse le coup, avec soulagement semble-t-il. Il n’est plus question de ses amours, mais il n’aime pas ce qu’il entend. D’un ton rude, il lance :
- Pour quoi faire ?
- Pour faire du théâtre.
Il regarde la secrétaire qui veut faire du théâtre. C’est comme si j’avais enlevé une perruque et qu’il découvrait que j’étais chauve.
- Vous avez tort.
- Et pourquoi s’il vous plait ?
- Parce que faire du théâtre n’est pas ce que vous croyez.
- Savez-vous seulement ce que je crois ?
Il se lève. Sa voix a quitté le ton de la conversation mondaine.
- Oh oui, je le sais : vous croyez que c’est facile, que ça brille, qu’on n’a qu’à parler et que les gens applaudissent, et que l’on joue tous les rôles qu’on veut, toujours,...
- Non, vous vous trompez. Je sais que c’est difficile et long, et frustrant. Mais je veux essayer. Et pourquoi toutes ces comédiennes que vous admirez ont-elles le droit d’en faire et pas moi ?
Il se plante devant moi et me parle en se penchant, avec véhémence.
- Parce qu’elles sont folles ! Oui, il faut avoir la folie en soi pour faire du théâtre, il faut être fou ! Et vous êtes tout ce qu’il y a de plus normale !
Il me gifle avec ce mot. Il n’y a plus de larmes, il y a la colère.
- Qu’est-ce que vous en savez ? Est-ce que vous me connaissez?
Il se redresse et retourne s’asseoir à son bureau.
- Oh, non, bien sûr je ne vous connais pas. Il y a bien un peu de folie dans chacun de nous.... Mais je vous vois plutôt mariée, avec de beaux enfants, vous êtes si tendre...
Normale et tendre. Je hais cet homme qui ne comprend rien aux apparences.
Il y a un silence.
Camus feuillette les documents posés devant lui, il les lit à peine et les signe.
Puis il referme le dossier et me le tend. Je me lève.
Alors il fait le tour du bureau, vient face à moi et comme je baisse la tête, il lève du doigt mon menton, et ses yeux plongent dans les miens. C’est le moment où mes larmes arrivent malgré moi.
- Mon petit. Je vous ai fait de la peine. Je vous ai dit le fond de ma pensée, je n’avais pas le droit, c’est absurde...
Il essuie la première larme sur ma joue d’un doigt paternel.
- Ecoutez-moi. Nous allons faire un pacte. Après cette conversation, réfléchissez. Faites ensuite exactement ce que vous sentez, suivez votre instinct. Je vous donne rendez-vous dans un an. Nous prendrons une soirée entière, je vous emmènerai dîner. Et vous me raconterez ce que vous aurez tenté... ou non tenté... Vous me prouverez peut-être que j’ai eu tort ?
Il me serre contre lui.
- Nous voulons tout... Je suis comme vous... Il faudrait plusieurs vies. Après tout se tromper est encore la meilleure façon de se trouver. Mais le théâtre est un maquis...
Je m’écarte de lui :
- Tous les métiers sont un maquis, monsieur.
- C’est la vérité. Vous avez le dernier mot. Maintenant les choses vont se précipiter, je n’aurai plus une minute à moi. Mais n’oubliez pas : dans un an... Je n’ai qu’une parole.
Nous étions le 28 décembre 1958. Un an plus tard, il allait quitter sa maison de Lourmarin et prendre la route vers Paris où je l’ai attendu en vain.



 JOAN SFAR N'A PAS TRAHI SON MODÈLE
JOAN SFAR N'A PAS TRAHI SON MODÈLE PATRICE LECONTE MET SA GRIFFE SUR GAVALDA
PATRICE LECONTE MET SA GRIFFE SUR GAVALDA RACHIDA BRAKNI DOMPTE ERIC CANTONA
RACHIDA BRAKNI DOMPTE ERIC CANTONA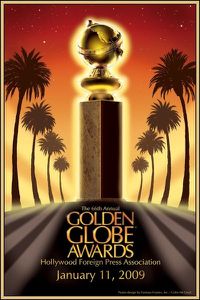 Les Américains aiment ceux qui gagnent. C’est pas comme nous, qui ch
Les Américains aiment ceux qui gagnent. C’est pas comme nous, qui ch
 MON 2ÈME ROMAN ENTRE DANS LA DANSE
MON 2ÈME ROMAN ENTRE DANS LA DANSE  DUTRONC, lui, s’offre un come-back vivant, ce qui est un peu plus joyeux.
DUTRONC, lui, s’offre un come-back vivant, ce qui est un peu plus joyeux. Oui, on est en plein suspense. Première étape : LE SUSPENSE.
Oui, on est en plein suspense. Première étape : LE SUSPENSE. Camus est vêtu d’un costume léger bleu marine. Sous la veste, son éternel gilet de laine gris. Il a l’air fatigué. Son bureau est encombré de livres, de papiers, de photos d’acteurs. La fenêtre est fermée.
Camus est vêtu d’un costume léger bleu marine. Sous la veste, son éternel gilet de laine gris. Il a l’air fatigué. Son bureau est encombré de livres, de papiers, de photos d’acteurs. La fenêtre est fermée. 

 Tiens, bonjour ! Qu’est-ce qui s’est passé ? Je crois que j’ai un peu dormi.
Tiens, bonjour ! Qu’est-ce qui s’est passé ? Je crois que j’ai un peu dormi.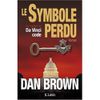 600 000 exemplaires vendus en un mois du SYMBOLE PERDU en France.
600 000 exemplaires vendus en un mois du SYMBOLE PERDU en France.

/image%2F1527747%2F20211206%2Fob_1ee441_champagne-best.JPG)